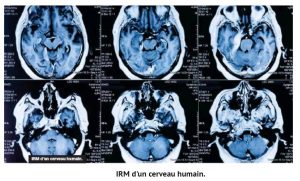Views: 1936
Sommaire de la page
Notre cerveau n’est pas un disque dur
L’animatrice Flavie Flament a mis sous la lumière le concept d’«amnésie traumatique». S’appuyant sur cette notion contestée par la majorité de la communauté scientifique, certains réclament l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Or, on sait que notre cerveau est un organe dynamique, pas un enregistreur que l’on pourrait rembobiner pour retrouver tel ou tel souvenir enfoui.
Causeur N° 55 le 6 Mar 2018
Brigitte Axelrad
L’amnésie traumatique en question
Des victimes présumées d’abus sexuels subis au cours de leur enfance ont récemment occupé et occupent encore le devant de la scène médiatique, en particulier l’animatrice et romancière Flavie Flament, qui a placé la notion d’« amnésie traumatique » au cœur du débat. C’est cette notion que l’on conteste ici.
Dans son récit autobiographique, La Consolation, publié en octobre 2016 et dédié « à tous ces enfants réduits au silence, à qui la mémoire et la parole sont revenues trop tard, à tous ces enfants qu’il est encore temps de consoler », Flavie Flament raconte son viol à l’âge de 13 ans par un photographe « connu et reconnu de tous ». La jeune femme dit n’avoir retrouvé la mémoire de ce viol, qui remonte à 1987, qu’en 2009, au cours d’une psychothérapie, « oubli » qu’elle attribue à l’« amnésie traumatique ». Si Flavie Flament ne nomme pas son présumé agresseur, après son passage fin octobre 2016 dans l’émission « Salut les Terriens ! », pendant laquelle Thierry Ardisson prononce son nom (qui sera bipé lors de la diffusion), le patronyme du célèbre photographe David Hamilton commence à circuler sur les réseaux sociaux et dans certains médias.
Le sujet de l’amnésie traumatique étant ainsi inscrit à l’ordre du jour médiatique, la psychiatre Muriel Salmona lui confère une substance scientifique, en reprenant les théories développées dans les années 1990 par Linda Meyer Williams du Wellesley College et Cathy Widom de l’université de New York, toutes deux spécialistes des abus sexuels et violences sur mineurs. Voici sa définition, citée par la journaliste Mié Kohiyama dans une tribune publiée par Le Monde en novembre 2017 : « Il s’agit d’un mécanisme neurobiologique de sauvegarde bien documenté que le cerveau déclenche pour se protéger de la terreur et du stress extrême générés par les violences qui présentent un risque vital (cardiovasculaire et neurologique). […] Ce mécanisme fait disjoncter les circuits émotionnels et ceux de la mémoire, et entraîne des troubles dissociatifs et de la mémoire, responsables des amnésies et d’une mémoire traumatique. »
Selon Muriel Salmona, les souvenirs ainsi retrouvés plusieurs décennies plus tard seraient restitués à l’identique. Elle écrit : « La mémoire traumatique est une mémoire émotionnelle et sensorielle non intégrée et indifférenciée, piégée lors de la disjonction de sauvegarde hors du temps et de la conscience dans une partie du cerveau : l’amygdale cérébrale. Elle fonctionne comme une machine à remonter le temps qui va faire vivre à l’identique dans leurs moindres détails et avec une acuité intacte les violences comme si elles se produisaient à nouveau, le tout accompagné des mêmes terreurs, douleurs, émotions et sensations au moindre lien qui les rappelle. »
Un prétexte pour l’allongement du délai de prescription
Sur la base de cette argumentation, Muriel Salmona défend l’allongement du délai de prescription pour les abus sexuels infantiles qui auraient eu lieu plusieurs décennies auparavant. Or, la majeure partie de la communauté scientifique aux Etats-Unis et en Europe considère que l’amnésie dissociative traumatique, autrement appelée « refoulement », est, ainsi que l’écrit le professeur en psychologie à Harvard Richard McNally, un « morceau de folklore dénué de tout fondement scientifique convaincant ».
Comment en avoir le cœur net ? On ne peut évidemment pas expérimenter directement sur les humains en les violant, en les torturant ou en les bombardant pour vérifier en laboratoire qu’un certain pourcentage de sujets développera – ou non – une amnésie traumatique. Aussi, de nombreuses études scientifiques ont-elles été effectuées sur la base de questionnaires dont les réponses font l’objet de méta-analyses. Si l’une d’entre elles, publiée en 2012 par la spécialiste des phénomènes post-traumatiques, Constance J. Dalenberg, a conclu à l’existence de la mémoire traumatique, des spécialistes du fonctionnement de la mémoire l’ont sévèrement critiquée. Les psychologues américains Scott Lilienfeld et Elizabeth Loftus battent en brèche la notion de mémoire retrouvée, cette dernière ayant notamment travaillé sur la fabrication des faux souvenirs, y compris autour d’abus sexuels prétendument subis durant l’enfance. Un constat ressort de ce débat entre spécialistes : la majeure partie de la communauté scientifique émet de sérieux doutes sur l’existence même de l’amnésie et de la mémoire traumatiques. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire : les partisans de l’amnésie et de la mémoire traumatiques se tournent vers l’imagerie par résonance magnétique (IRM), prétendant y découvrir la preuve scientifique par excellence. Là encore, Flavie Flament est aux avant-postes.
Dans son documentaire Viol sur mineurs : mon combat contre l’oubli, diffusé le 15 novembre 2017 sur France 5, Flavie Flament se prête à un scanner de son cerveau afin de déterminer si son présumé viol a laissé des séquelles physiques visibles. Selon les images présentées dans le documentaire, les violences que l’animatrice aurait subies trente ans auparavant, à l’âge de 13 ans, auraient provoqué des modifications visibles du cortex cérébral. J’ai donc demandé à des spécialistes en neuro-imagerie de se prononcer sur les images du cerveau de Flavie Flament. Tous ont constaté que l’hippocampe de Mme Flament était certes petit (et encore, pour s’en assurer, il faudrait mesurer correctement son volume, et le rapporter à des normes de femmes de même âge et de même taille, pas juste jeter un coup d’œil rapide à une image !), mais que l’IRM ne pouvait en aucun cas l’expliquer.
Notre mémoire ne fonctionne pas comme un enregistreur vidéo
Notre mémoire ne fonctionne pas comme un enregistreur vidéo. Tant que son détenteur vit, le cerveau reste dynamique et les souvenirs traumatiques les plus vifs ne sont jamais des reproductions littérales des événements vécus. Ni des éléments manipulables à l’envi qu’on pourrait sortir de l’endroit où ils ont été cachés par tel ou tel mécanisme psychologique.
D’autant qu’un souvenir n’est qu’une reconstruction du passé. Bien sûr, on peut faire des rêves étroitement liés à l’événement traumatique, ainsi reconstruit et « revécu » pendant le sommeil, mais de telles réminiscences ne sont en aucun cas des reproductions ou des enregistrements retrouvés dans un coin du grenier.
Le corps peut-il vraiment garder l’empreinte du souvenir ?
Question subsidiaire : le corps peut-il vraiment garder l’empreinte du souvenir ? Dans le titre même de son article « The body keeps the score », le psychiatre Bessel Van der Kolk suggère que les victimes peuvent présenter des signes corporels de la mémoire traumatique. Mais la communauté scientifique est unanime : même si cela existe, il ne s’agit pas d’une reproduction fidèle de l’événement. Dans ces conditions, comment interpréter la « mémoire du corps » ? Approuvant la théorie de Van der Kolk, L. S. Brown et d’autres ont affirmé qu’elle autorisait les thérapeutes à interpréter « les souvenirs du corps, les flashbacks, les fragments, les sentiments intenses soudains, les comportements d’évitement, les images, les processus sensoriels et les rêves » comme les souvenirs implicites d’un traumatisme dissocié. Le corps se souviendrait, même si l’esprit ne le peut pas.
La ” thérapie de la mémoire retrouvée est la plus grave catastrophe qui ait frappé le domaine de la santé mentale depuis l’époque de la lobotomie .” Richard McNally,
Ce raisonnement erroné a inspiré la prétendue « thérapie de la mémoire retrouvée » que Richard McNally, le spécialiste des légendes urbaines en matière de psychologie, qualifie de « plus grave catastrophe qui ait frappé le domaine de la santé mentale depuis l’époque de la lobotomie ». Rappelons également que l’émotion ne confirme pas la vérité. La croyance sincère que l’on a été traumatisé peut produire une excitation émotionnelle intense au moins aussi grande qu’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Par exemple, l’amnésie psychogène ne se confond pas avec l’amnésie traumatique, bien que les deux termes soient parfois utilisés comme des synonymes. Ainsi, les cas d’amnésies psychogènes « canoniques » se manifestent par une perte de la mémoire à long terme soudaine et massive, allant jusqu’à la perte d’identité.
Ne confondons pas non plus amnésie infantile et amnésie traumatique. La plupart des gens se souviennent très peu de leur vie avant l’âge de 4 ou 5 ans. Au-delà de cette limite, la maturation du cerveau et les changements cognitifs, en particulier dans le langage, rendent difficile pour les enfants plus âgés – et a fortiori pour les adultes – de se rappeler les événements « codés » pendant les années préscolaires. Les travaux d’Elizabeth Loftus et d’autres chercheurs en psychologie expérimentale ont montré qu’il était facile d’implanter des faux souvenirs. Sans corroboration externe ou preuves matérielles, les allégations d’une victime présumée ne suffisent pas à distinguer un vrai d’un faux souvenir. En revanche, de multiples exemples démontrent que les événements traumatiques – vécus comme massivement terrifiants au moment de leur apparition – sont fortement inoubliables et rarement, sinon jamais, oubliés.
Former les médecins, les policiers les gendarmes, les avocats et les juges
Il est indispensable de développer la formation des médecins, policiers, gendarmes, avocats, juges et autres professionnels à l’écoute des victimes afin de mieux entendre et préserver leurs témoignages de tout risque de déformation. Mais en même temps, force est de constater que, dans l’état actuel de nos connaissances, la « mémoire traumatique retrouvée » n’est pas de la science, mais de la science-fiction. Comme l’affirment quatre chercheurs en psychologie sociale et cognitive dans Le Monde du 22 novembre 2017, « faire entrer dans la loi l’amnésie traumatique serait dangereux ». C’est aussi la position du juge Jacques Calmettes, chargé fin 2016 par la ministre Laurence Rossignol d’animer avec Flavie Flament une « Mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s ». Lors de son audition à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018, Calmettes a été interrogé sur l’amnésie traumatique : « La Cour de cassation a une position très claire de rejet disant que cette base de révélations, les conditions de ces révélations et les connaissances, les données acquises de la science, comme on le dit souvent en droit, ne permettent pas d’asseoir la procédure sur ce problème-là, trop fragile par rapport à la rigueur du droit. » Il a également évoqué « le problème de la preuve du souvenir, de la fabrication des faux souvenirs, de la distorsion des souvenirs ».
S’il faut lutter énergiquement contre les abus sexuels et les viols avérés sur mineurs, n’oublions pas pour autant une autre catégorie de victimes : les personnes innocentes – et leurs familles – victimes d’accusations fondées sur de faux souvenirs induits en thérapie. Dans un entretien qu’elle a accordé à Stéphanie Trastour (M, le magazine du Monde, 4 octobre 2014), en marge du premier procès en France intenté contre un psychothérapeute des faux souvenirs, Elizabeth Loftus déclarait : « Si les Français doivent traverser le même épisode tragique que les Américains lors de la guerre des souvenirs, je les plains sincèrement ! »
Dans l’état actuel de nos connaissances, la «mémoire traumatique retrouvée» n’est pas de la science mais de la science-fiction.
*Brigitte Axelrad est professeur honoraire de philosophie et de psycho-sociologie, membre du comité de rédaction de Science et pseudosciences.